SOCIÉTÉ
SÉNÉGAL : VOIX DE FEMMES : L’immunité médiatique : un privilège masculin ?

Qui a droit à une immunité médiatique ? L’information est-elle exclusivement masculine ? Comment les représentations des femmes dans les médias contribuent-elles à accroître les inégalités entre les sexes et à imprimer dans les imaginaires féminins et masculins, une image dévalorisante des femmes ?
La libéralisation du secteur audiovisuel et la recherche de buzz de la presse en règle générale accentuent les divisions entre hommes et femmes. Les médias se font de plus en plus le relais de discours violents et misogynes sur nos corps, nos attitudes, nos comportements et les valeurs que nous sommes supposées incarner et transmettre à notre progéniture. Cela se traduit par une essentialisation de la femme sénégalaise respectueuse d’un certain conformisme à l’image de femmes vertueuses dont la qualité est avant tout d’être mère, fille, sœur de personnages illustres de notre histoire. L’on subit l’instrumentalisation exaltée de leur abnégation, de leur soumission, de leur patience, de leur générosité, de leur dévouement qui n’aurait d’autre fonction que de rappeler les « déviantes » à l’ordre et légitimer la domination masculine, en perpétuant une identité féminine figée dans laquelle nous ne nous reconnaissons guère.
La plupart des médias, faits par et pour les hommes, offrent une représentation biaisée des femmes et passent sous silence les oppressions qu’elles subissent. On pense notamment à tous ces articles et émissions télévisées qui, lorsqu’ils décident d’aborder la question des violences faites aux femmes, reproduisent une analyse stéréotypée des situations, sans tenir compte de l’asymétrie du pouvoir entre hommes et femmes et en affichant clairement un parti pris qui perpétue le privilège masculin. Il faut également dénoncer toutes les émissions religieuses qui produisent, à foison, des discours réactionnaires sur les femmes ; celles dans lesquelles des animatrices interrogent des hommes et quelquefois d’autres femmes supposé-e-s savoir ce que les textes religieux prescrivent aux femmes, en matière de soumission à l’ordre moral masculin. Cet angle de traitement de l’information protège les hommes, avec en arrière-plan l’idée de comprendre leur vécu, sans jamais porter attention aux conséquences de la violence sur les femmes qui la vivent. Il leur est accordé d’office une sorte d’immunité médiatique permettant de les blanchir de tout péché. Rappelons-nous il y a sept ans, une affaire de viol avait défrayé la chronique. Un célèbre journaliste avait été confronté à une jeune femme qui l’avait accusé de viol. Cette affaire renforce ce dont nous parlons aujourd’hui. La quasi-totalité des journaux, radios et sites web avaient participé à blâmer la victime par une sorte de chasse aux sorcières mettant l’emphase sur la victime, en lui reprochant ses comportements jugés non conventionnels.
Quant au coupable après qu’il ait purgé une partie de sa peine de prison, il s’est refait une virginité médiatique. En effet, les médias à sensation mettent souvent davantage la focale sur la victime, en n’hésitant pas à détailler la vie et/ou les agressions subies, le tout accompagné de propos disqualifiants, voire diffamants. A cela s’ajoute une omission des mêmes détails sur les auteurs, leur offrant presque une anonymisation ou transformant certains auteurs de violences en victimes de l’hystérie féminine subséquente. Pour les victimes, le traitement par le buzz, la peopolisation ou la légèreté des termes employés pour parler de ces crimes et situations extrêmement graves par lesquelles elles sont passées ainsi que le sexisme systémique rajouté au sordide, constituent un traumatisme cumulatif. Traumatisme en chaîne, dans un contexte social qui, encore aujourd’hui, impute, aux victimes femmes, la faute de ce qu’elles ont subi. Tout ceci restreint les possibilités pour ces femmes de se relever de telles atrocités. Ce traitement médiatique est aussi désastreux et entravant pour les professionnels de santé, qui faute de pouvoir compter sur un système de prévention et des relais psychosociaux structurés et efficaces, se retrouvent à jouer les pompiers de situations fortement compromises du fait de ces traumatismes cumulatifs auxquels participent bien largement les organes de presse.
Sept ans après cette première affaire, où en est-on ? Le constat est amer. Entre un professeur de philosophie qui fait l’apologie du viol pendant une émission dédiée à la journée internationale des droits des femmes et une femme traitée de folle, car elle a osé parler d’une grossesse contractée hors des liens du mariage, l’on voit que la situation est toujours la même.
Les mobilisations autour des hashtags #Nopiwuma #Doyna #TontonSaïSaï #BalanceTonSaïSaï et plus récemment les sorties sur les réseaux sociaux de Ndella Madior Diouf étaient une belle occasion pour les médias de soutenir les droits des femmes en amplifiant, par une enquête sérieuse, sa voix et celles de centaines d’autres qui vivent une situation similaire ou auraient subi des agressions sexuelles et qui l’ont appelée pour partager leur vécu.
Force est de constater que, depuis l’éclatement de cette affaire, l’angle de traitement des médias demeure sensiblement le même. Les gros titres des journaux dépeignent ces “mauvaises” femmes comme des êtres aux mœurs légères, sans scrupules, de sorte que toute la faute est rejetée sur elles, encore une fois. Le refus de paternité, thème majoritairement traité, donc de responsabilité de l’homme de ses actes, l’est en jetant l’opprobre sur les femmes, et pis même, en faisant intervenir des experts masculins pour la plupart qui viendront expliquer soit d’un point de vue juridique ou religieux une situation qui concerne aussi bien les hommes que les femmes.
Cette démarche n’est nullement cohérente avec le devoir d’informer dans le respect des règles d’éthique et de déontologie. Un travail journalistique sérieux et engagé doit « centrer » les voix des premières concernées. La presse contribue à la socialisation des garçons et des filles, tout en fabriquant et reproduisant des modèles et rôles sociaux. Il serait donc important d’avoir des perspectives journalistiques qui contribuent à démarginaliser les groupes exclus et réduire les inégalités entre les femmes et les hommes à travers des représentations anti-oppressives.
Pour sensibiliser, il faudrait que les médias utilisent des mots plus justes dans la façon de représenter les femmes et qu’ils évitent de minimiser la souffrance des premières concernées par le silence, le sensationnalisme ou encore la banalisation de l’expérience. Un féminicide n’est pas un “drame conjugal”.
Nous proposons que les groupes de presse fassent un travail de fond sur la suppression des stéréotypes, qu’on se questionne sur les choix des invité.e.s, que l’on déconstruise le climat sexiste qui autorise l’expression de propos discriminants sur les plateaux. Une telle démarche ne saurait se faire sans une formation approfondie sur les représentations sexuées des rôles et statuts sociaux et une réflexion sur les préjugés des médias en lien notamment avec la classe, l’origine, les opinions, les choix politiques, l’appartenance religieuse – et de réelles stratégies de prise en compte des voix de toutes.
Les signataires :
Pr Mame-Penda Ba UFR Sciences Juridiques et Politiques, Université Gaston Berger Directrice du LASPAD (Laboratoire d’Analyse des Sociétés et Pouvoirs/Afrique-Diaspora)
Dr Selly Ba, Sociologue
Dr Oumoul Khaïry Coulibaly, sociologue et spécialiste genre
Dr Halima Diallo, psychologue sociale et chargée de cours
Dr. Rama Salla DIENG Lecturer in African Studies and International Development, University of Edinburgh
Fatou Kiné Diouf, commissaire d’exposition indépendante
Ndèye Yacine Faye, Réseau des jeunes femmes leaders d’Afrique de l’Ouest et chargée de communication de Dafa Doy
Mariama Faye, Spécialiste en Sciences Sociales, Militante des droits des Femmes et membre d’Organisations de la Société Civile
Diakhoumba Gassama, juriste, membre des Forum Féministe Sénégalais et Africain et du conseil d’administration de l’Association pour les Droits des Femmes dans le Développement (AWID)
Marame Guèye, Ph.D., Associate Professor of African and African Diaspora Literatures and Gender, Department of English, East Carolina University
Marina Kabou, juriste, doctorante, membre de l’AJS, Coordinatrice du collectif DafaDoy
Ndèye Fatou Kane, Études sur le genre, EHESS Paris
Laïty Fary Ndiaye, sociologue, organisatrice communautaire, chercheure associée à l’Institut Simone de Beauvoir (Concordia University) et membre fondatrice du collectif Jàma
Daba Ndione, sociologue
Fatou Warkha Sambe, Militante pour le Respect des droits de femmes et fondatrice de WarkhaTv
Dr Fatou Sow, sociologue, ancienne chercheuse CNRS/UCAD
Khaïra THIAM psychologue clinicienne, spécialisée en pathologies psychiatriques et criminologie clinique
Maïmouna Eliane Thior, doctorante en sociologie
JUSTICE
AFRIQUE DU SUD – Un chauffeur Bolt tué, trois suspects inculpés
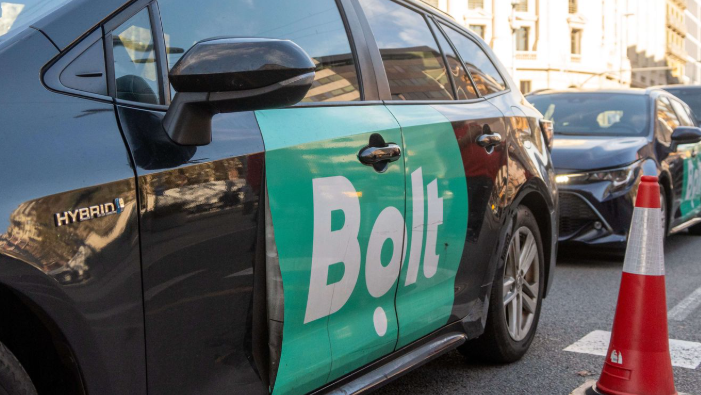
Le meurtre d’un chauffeur de VTC filmé par une caméra embarquée a provoqué une onde de choc en Afrique du Sud. Trois personnes ont été inculpées pour meurtre et vol aggravé après la mort d’Isaac Satlat, 22 ans, ressortissant nigérian, attaqué alors qu’il effectuait une course via la plateforme Bolt.
Les faits se sont produits la semaine dernière. Selon les éléments présentés par l’accusation, les suspects auraient réservé la course à l’aide d’un numéro de téléphone non enregistré à leur nom. Deux d’entre eux seraient montés à bord du véhicule tandis que les deux autres suivaient dans une voiture distincte. Le chauffeur aurait ensuite été contraint de s’arrêter avant d’être violemment agressé.
La séquence enregistrée par la dashcam montre une altercation entre la victime et ses passagers. D’après le parquet, Isaac Satlat aurait été étranglé jusqu’à perdre connaissance. Les suspects auraient ensuite pris la fuite avec son téléphone portable et son véhicule, retrouvé ultérieurement par les autorités.
Lundi, Dikeledi Mphela (24 ans), Goitsione Machidi (25 ans) et McClaren Mushwana (30 ans) ont comparu devant un tribunal à Pretoria. Ils ont renoncé à solliciter une libération sous caution. Un quatrième suspect s’est rendu à la police et doit comparaître prochainement. L’affaire a été renvoyée à la semaine suivante pour la poursuite de la procédure.
Au-delà du drame individuel, l’affaire ravive les inquiétudes concernant la sécurité des chauffeurs de VTC dans un pays confronté à un niveau élevé de criminalité. Des représentants du secteur ont dénoncé un crime qui, selon eux, s’inscrit dans une série d’attaques similaires. Ils estiment que les images diffusées sur les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans l’identification rapide des suspects.
Plusieurs organisations réclament désormais un renforcement des dispositifs de vérification des passagers par les plateformes numériques, ainsi que la mise en place de mécanismes de protection et d’indemnisation pour les conducteurs.
La famille d’Isaac Satlat affirme pour sa part que l’agression n’est pas liée à sa nationalité, dans un contexte sud-africain parfois marqué par des tensions xénophobes. Ses proches disent attendre que la justice établisse les responsabilités dans cette affaire qui a profondément ému l’opinion.
ENVIRONNEMENT
PORTUGAL – Alcácer do Sal en alerte face à la tempête Leonardo

La ville portugaise d’Alcácer do Sal se trouve une nouvelle fois sous la menace des inondations, alors que les autorités anticipent une élévation du niveau des eaux liée à la marée et aux lâchers contrôlés des barrages. Dans le centre-ville, la vigilance est de mise et les habitants s’organisent pour limiter les dégâts.
Face à la progression des eaux, de nombreux commerçants ont installé des rangées de sacs de sable devant leurs établissements afin de protéger leurs biens. Malgré ces efforts, une grande partie de l’avenue principale demeure submergée, compliquant la circulation et l’activité économique locale.
À l’échelle nationale, la protection civile a recensé plus de 3 300 interventions en lien avec les intempéries. Plusieurs centaines de personnes ont été contraintes de quitter leurs domiciles, tandis que l’armée a été mobilisée pour soutenir les équipes de secours dans les zones les plus touchées.
À Alcácer do Sal, le plan d’urgence municipal reste pleinement activé. Les autorités envisagent jusqu’à 80 nouvelles évacuations, principalement dans les logements situés en rez-de-chaussée et dans les garages, particulièrement exposés aux infiltrations.
Aucun décès récent n’a été signalé dans la commune, mais l’inquiétude demeure vive parmi les habitants, marqués par les inondations provoquées par la tempête Kristin fin janvier. Beaucoup redoutent une répétition de ce scénario, aux conséquences lourdes pour les infrastructures et les populations.
La tempête Leonardo s’inscrit dans une succession d’épisodes météorologiques extrêmes qui frappent actuellement la péninsule ibérique. Selon les services météorologiques, un pic d’intensité marqué par de fortes pluies et des vents violents est attendu dans la nuit du 5 au 6 février, maintenant les autorités en état d’alerte renforcée.
ENVIRONNEMENT
MAROC – Plus de 80 000 déplacés après de fortes pluies

La ville de Ksar el-Kebir, située dans le nord du Maroc, traverse une période critique après plusieurs jours de pluies intenses ayant provoqué d’importantes inondations. Face à la montée des eaux et aux risques pour les habitants, les autorités ont activé un plan d’urgence et renforcé les opérations de secours.
La Gendarmerie royale, appuyée par les services de protection civile, a procédé à l’évacuation de nombreux résidents en difficulté. Un important dispositif logistique a été mis en place, mobilisant des véhicules tout-terrain et des camions pour assurer le transport des sinistrés, ainsi que l’acheminement de vivres et de produits de première nécessité.
Parallèlement, un dispositif d’accompagnement social et humanitaire a été déployé afin d’apporter un soutien psychologique et matériel aux familles touchées par la catastrophe.
La situation s’est aggravée dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque de violents orages, accompagnés de rafales soutenues, ont entraîné une nouvelle montée du fleuve Oued Loukkos. Plusieurs quartiers, zones périphériques et axes routiers ont été submergés, compliquant davantage les opérations de secours.
Dans l’ensemble de la province de Larache, plus de 80 000 personnes ont été contraintes de quitter leurs habitations. À Ksar el-Kebir, près de 85 % de la population a dû être évacuée, soit avec l’aide des autorités, soit par leurs propres moyens, dans un contexte d’urgence permanente.
Les autorités marocaines restent en état d’alerte maximale, alors que les prévisions météorologiques annoncent de nouvelles précipitations susceptibles d’atteindre des niveaux records. Des dispositifs de surveillance renforcée ont été mis en place afin d’anticiper toute aggravation de la situation.
-

 AFRIQUE2 mois .
AFRIQUE2 mois .GUINÉE ÉQUATORIALE – Ciudad de la Paz devient officiellement la nouvelle capitale
-

 SOCIÉTÉ1 mois .
SOCIÉTÉ1 mois .ÉTATS-UNIS – À Lagos, IShowSpeed franchit les 50 millions d’abonnés et confirme son impact mondial
-

 AFRIQUE3 mois .
AFRIQUE3 mois .BÉNIN – Otages libérés, opérations de ratissage en cours après la tentative de coup d’État
-

 CULTURE3 mois .
CULTURE3 mois .CÔTE D’IVOIRE – Josey dévoile « Raisonance », un album intime et puissant
-

 AFRIQUE3 mois .
AFRIQUE3 mois .GUINÉE – La famille d’Elie Kamano ciblée : l’ONU alerte sur des enlèvements inquiétants
-

 CULTURE1 mois .
CULTURE1 mois .GUINÉE – AFRIMA 2026 : Bangoura Manamba Kanté sacrée reine de la pop africaine
-

 PEOPLE2 semaines .
PEOPLE2 semaines .CÔTE D’IVOIRE – Mariage de Sindika et Liliane Maroune : quand l’amour réunit talent, élégance et émotion
-

 EUROPE3 mois .
EUROPE3 mois .ROYAUME-UNI – Londres menace l’Angola, la Namibie et la RDC de restrictions de visas














